De la Renaissance aux Lumières
 Un paysage avec des ruines est tellement plus évocateur ! Dans les premières années du XVIIe siècle, le peintre flamand Paul Brill installe son marché aux bestiaux sur le forum romain avec les colonnes du temple de Castor et Pollux et la basilique d’Hadrien.
Un paysage avec des ruines est tellement plus évocateur ! Dans les premières années du XVIIe siècle, le peintre flamand Paul Brill installe son marché aux bestiaux sur le forum romain avec les colonnes du temple de Castor et Pollux et la basilique d’Hadrien.Vue du Campo Vaccino, Paul Bril, 1600. Dresde, Gemäldegalerie, Alte Meister. © AKG-images
Une innovation majeure intervient dès la Renaissance : le dessin archéologique. À l’exploration et l’appropriation physique du passé s’ajoute désormais sa représentation comme moyen de connaissance et source de prestige. Après l’humaniste italien Cyriaque d’Ancône, les nombreux voyageurs en Méditerranée ne se contentent plus de décrire les antiquités qu’ils observent. Les techniques du relevé architectural transforment la connaissance des monuments et l’image gagne une place prépondérante dans la démarche antiquaire. À Rome, à l’instar des architectes, les érudits cartographient et dessinent des monuments, des inscriptions et des objets de l’Antiquité classique. Plus encore, ils entreprennent aussi de faire fouiller le sol pour en dégager de nouveaux vestiges.
Profitant de l’essor de l’imprimerie, atlas et catalogues illustrés se répandent en Allemagne, en Angleterre et en France au fur et à mesure que croît l’engouement pour les antiquités. En Scandinavie, située au-delà du monde romain, ce sont les inscriptions runiques, les mégalithes et les tombes anciennes (d’une époque que l’on qualifiera par la suite de « préhistorique » ou de « protohistorique ») qui intéressent des érudits tels que Olé Worm et Olaf Rudbeck.
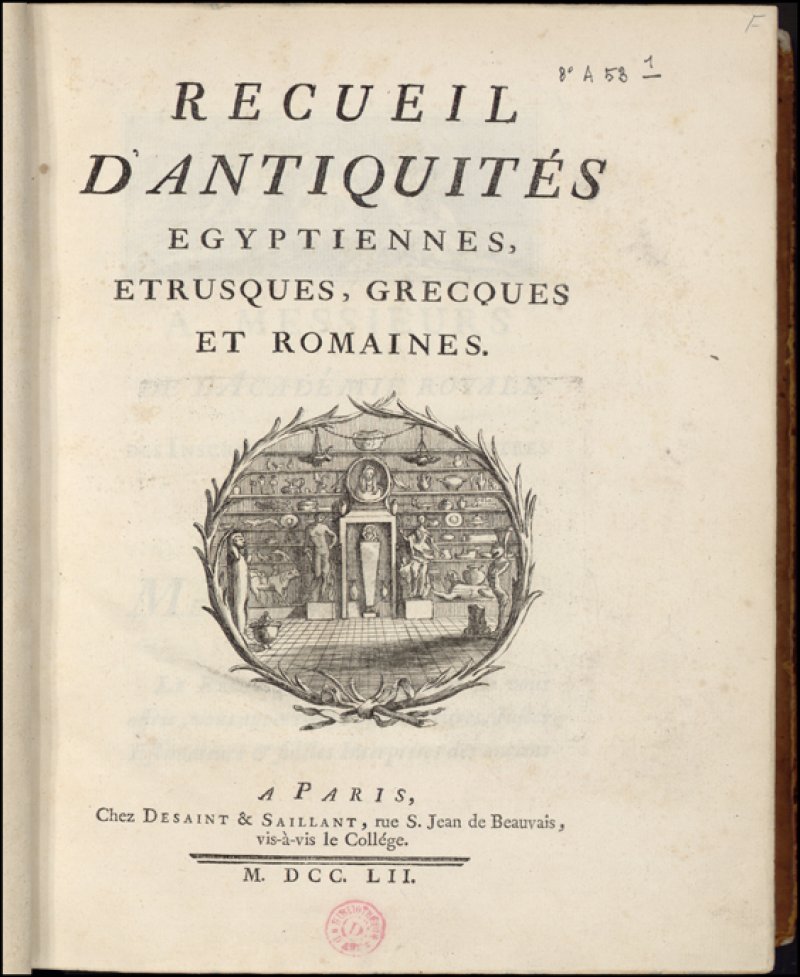 Momies, statues et vases élégamment mis en scène dans un cabinet d’antiquités illustrent le frontispice du premier tome du Recueil d’antiquités égyptienne, étrusques, grecques et romanes, l’œuvre majeure du comte de Caylus.
Momies, statues et vases élégamment mis en scène dans un cabinet d’antiquités illustrent le frontispice du premier tome du Recueil d’antiquités égyptienne, étrusques, grecques et romanes, l’œuvre majeure du comte de Caylus.Collections Jacques-Doucet. © Bibliothèque de l'INHA
Fouilles, relevés et dessins permettent aux antiquaires des Lumières d’étoffer leurs collections et leurs cabinets avec des publications de plus en plus spécialisées. Les encyclopédies illustrées de Cassiano dal Pozzo et de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc au XVIIe siècle sont remplacées par des recueils plus systématiques ; les mieux connus sont L’Antiquité expliquée et représentée en figures du bénédictin Bernard de Montfaucon (1719) ou le monumental Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises en sept volumes, que fait paraître le comte de Caylus entre 1752 et 1768.
 Un débat animé autour d’objets archéologiques à la Society of antiquaries of London.
Un débat animé autour d’objets archéologiques à la Society of antiquaries of London. Dessin George Cruikshank, 1812. © Collection particulière
Ces publications visent à constituer des véritables bases de données imagées, où l’illustration de monuments et de vestiges devient une source historique à part entière. Bien ancrée dans la culture occidentale dès le XVIIe siècle, la démarche antiquaire se diffuse à travers l’Europe et s’exporte dans les colonies (notamment aux Amériques). Elle se spécialise aussi davantage, s’appuyant sur diverses institutions nouvellement créées. Le Cabinet des rois de France (1633, par la suite appelé Département des médailles, monnaies et antiques), l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1663) ou encore la Society of antiquaries of London (1707) sont parmi les premiers lieux où la connaissance du passé matériel s’expose et se débat.
