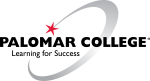Vous êtes ici

SIDERENT : Sidérurgie et environnement au Togo
SIDERENT a pour objectif de comprendre l’impact de la sidérurgie traditionnelle Bassar (nord Togo) sur l’environnement et la société en prenant en compte les dimensions sociale, rituelle et symbolique, la nature des ressources utilisées, les technologies employées et le contexte économique et politique.
Description du projet
Après l’agriculture, la métallurgie du fer révolutionna profondément les schémas organisationnels, économiques et technologiques des communautés humaines. Sa généralisation transforma durablement terroirs et territoires. Si ce principe est aujourd’hui admis, son ampleur et sa chronologie restent encore très largement méconnues. Le pays Bassar (Nord du Togo) offre un cadre unique pour avancer sur ces questions. Il permet à la fois d’étudier l’histoire des forgerons et l’impact de leurs activités sur la société et l’environnement. Malgré la disparition de la sidérurgie traditionnelle pourtant ancienne et intensive, la mémoire en est encore vivante et régulièrement étudiée, et la qualité du minerai attire encore les industriels.
Le pilier central du projet SIDERENT, sur lequel repose sa force et son ambition, est de répondre à des questions d’interaction Homme-Milieu par l’étroite association de toutes les familles scientifiques (humaine, naturelle et physique). Les recherches déjà effectuées et en cours nous permettent d’aller directement à l’essentiel :
- étudier la technicité, les volumes, la qualité du fer produit ;
- étudier les modalités de gestion des ressources naturelles ;
- estimer l’impact de la sidérurgie sur la société et l’environnement.
La production du fer en pays Bassar a débuté avant notre ère et a connu à partir du 14ème siècle une intensification de sa production en quatre périodes chronologiques distinctes (de Barros 1986). La quantité de fer produit pendant les trois dernières périodes dépassait la consommation locale en fer, ce surplus alimentant un marché régional, puis extrarégional. Durant les deux dernières périodes, le pays Bassar assiste à une sectorisation géographique de la chaîne opératoire : les villageois de Dimuri se spécialisent dans le charbonnage ; autour de Bandjeli et au nord de Bassar, les métallurgistes extraient et réduisent le minerai ; le fer est transformé par les forgerons de Bitchabe et des alentours, ainsi qu’au sud de Bassar. Cette situation permet des analyses à différentes échelles spatiales et chronologiques, des comparaisons entre les secteurs et l’élaboration de scénarios historiques retraçant la mise en place, le développement et la cessation d’activités sidérurgiques.
Quelques résultats marquants
Les enquêtes ethnologiques ont permis de produire un schéma renouvelé de l’histoire locale de la sidérurgie précoloniale. A travers divers exemples, elles illustrent et surtout révèlent les processus par lesquels se sont constituées les zones spécialisées dans chacune des deux activités de la chaîne opératoire en même temps qu’elles nous éclairent sur les constructions des identités contrastées des acteurs du travail métallurgique.
Des datations financées par le projet ont permis de réviser le cadre chronologique de certains sites sidérurgiques. La poursuite de la prospection dans de nouveaux secteurs met en lumière, pour la première fois en Afrique de l’Ouest, différents types de travaux miniers (tranchées, grattages, puits, galeries) sur un même secteur. L’analyse macroscopique des scories montre des traditions technologiques différentes dans la région bassar et semblent correspondre à la fois à des périodes chronologiques différentes et à l’utilisation de minerais de natures diverses. La mise en place de nouvelles méthodes d’analyse spatiale et quantitatives sur les deux plus grands ateliers sidérurgiques permet aujourd’hui de reprendre l’estimation du volume des scories produites mais surtout de connaître le poids de ses déchets. Ces procédés topographiques et archéologiques permettent des analyses en laboratoire sur les minerais et les scories afin de calculer le rendement des ateliers sidérurgiques. Leur quantification et plus particulièrement celle des amas de déchets métallurgiques est un enjeu dans la connaissance de la production de cette activité et de son impact économique, sociétal et environnemental. Différentes méthodes topographiques et archéologiques étaient déjà mises en place, mais aucune n’était pour l’instant reproductible, comparable et systématique. Il est donc difficile d’analyser les différents sites sidérurgiques entre eux et à différentes échelles de production. Ce volet de développement méthodologique avec des spécialistes de l’analyse spatiale est donc stratégique. Il initie une réflexion entre topographe, archéologue et archéomètre à des méthodes efficientes d’analyse.
Les études macroscopiques, minéralogiques et chimiques des minerais et des scories offrent pour la première fois une caractérisation des matières premières utilisées et des déchets produits. Elles mettent en évidence à la fois une évolution chronologique et une répartition géographique diverse des techniques de réduction. Le fer produit par les bas fourneaux dans la région Bassar, grâce à l’analyse métallographique d’objets ethnographiques, s’avère être majoritairement un acier.
Des analyses anthracologiques ont permis d’établir une certaine homogénéité des pratiques de sélection des essences ligneuses utilisées comme combustible suivant les différentes périodes chronologiques et les différentes aires géographiques. La réalisation d’un cadre chronostratigraphique met en lumière la répartition des sites sidérurgiques par rapport au contexte topographique, géomorphologique et hydrologique.