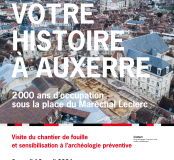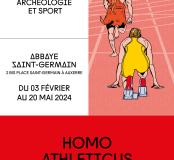Vous êtes ici
Yonne
À 3 km au sud de la ville d’Auxerre sur la rive droite de l’Yonne, les archéologues fouillent une surface d’1,6 ha au lieu-dit Sainte-Nitasse dans...
En amont de la construction d’une plate-forme logistique par la société de développement et d’investissement Stonehedge, en bordure de l’autoroute...
Entre février et août 2024, l'Inrap sur prescription de l’État (Drac Bourgogne-Franche-Comté) a procédé à la fouille d’une parcelle de 3,5...
Entre août et septembre 2024, l'Inrap a fouillé une surface de 200 m2 au sein de l’ermitage franciscain de La Cordelle, en amont de la...
La fouille de l’enceinte fortifiée (castrum) d'Autessiodurum du IVe siècle a révélé un espace funéraire antique dédié...
Depuis mars 2024, l’Inrap, sur prescription de l’Etat (DRAC Bourgogne - Franche-Comté) fouille sur les hauteurs de la ville de Tonnerre, en amont...
Depuis le 7 février 2024, une équipe composée de cinq archéologues de l’Inrap intervient place du Maréchal Leclerc en amont du...
Une équipe de l'Inrap fouille une surface de 500 m² au centre de la Place du Maréchal Leclerc à Auxerre en amont de son réaménagement paysager....
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024, l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre célèbre le sport à travers l’exposition « Au cœur de...
À Saint-Valérien, l'Inrap a fouillé une zone recélant des vestiges de l'antique cité des Sénons et révélé un ensemble cultuel inédit.